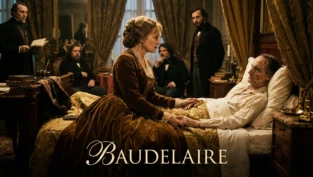Un Klapisch voyageur temporel
Après avoir exploré Barcelone, New York et les dessous de la danse contemporaine, Cédric Klapisch s’attaque à un terrain inattendu : la machine à remonter le temps. Dans La Venue de l’avenir, il juxtapose deux époques — 1895 et 2025 — pour tisser un récit familial qui oscille entre chronique générationnelle et rêverie historique. Le résultat ? Un film généreux, souvent touchant, parfois maladroit, mais toujours animé d’une sincère volonté de relier les gens entre eux… quitte à nouer un peu trop de nœuds au passage.
De Montmartre à Montparnasse, une fresque double
Le film suit quatre cousins contemporains réunis dans une vieille maison normande pour inventorier un héritage familial. En fouillant le passé, ils ressuscitent la figure d’Adèle, une aïeule partie à Paris à la fin du XIXe siècle. Ce prétexte permet à Klapisch de faire alterner scènes d’époque à la sauce impressionniste (très bien reconstituées) et saynètes modernes truffées de créateurs de contenus, d’apiculteurs baba-cool et de cadres sous anxiolytiques. Entre flashbacks sur pellicule et dialogues sur smartphone, le film multiplie les contrastes.
Impressionnisme numérique et charme de la reconstitution
L’une des réussites du film tient à sa reconstitution du Paris de 1895 : rues pavées, éclairage au gaz, premiers balbutiements de la photographie, Claude Monet qui passe dire bonjour… La reconstitution historique est soignée (trop, parfois, au point de frôler la brochure touristique) et la mise en scène joue habilement sur les transitions entre passé et présent. Klapisch trouve même quelques fulgurances visuelles où les murs décrépis redeviennent salons bourgeois d’un simple fondu enchaîné. Dommage que les effets spéciaux numériques soient un peu trop visibles, comme si le passé avait été repeint au stabilo.
Une galerie de personnages au bord du cliché
Côté casting, Klapisch aligne les talents confirmés (Cécile de France hilarante en historienne snob) et les jeunes pousses du cinéma français. Suzanne Lindon campe une Adèle délicate, lumineuse, même si son parcours reste sagement balisé. Face à elle, Vincent Macaigne en apiculteur râleur et Zinedine Soualem en prof attendrissant forment un duo attachant mais peu surprenant. Hélas, certains personnages modernes ressemblent plus à des caricatures qu’à de véritables êtres humains, tant ils semblent sortis d’un brainstorming de série Arte : la cadre surmenée, l’influenceur en crise existentielle, le vieux hippie écolo…
Klapisch, le cœur plus que la tête
Sur le fond, La Venue de l’avenir est fidèle à ce que Klapisch défend depuis toujours : les liens familiaux, la transmission, la difficulté de communiquer entre générations, le besoin de se reconnecter aux autres et à soi-même. Mais ici, le discours devient parfois pesant. L’ayahuasca, la « maison qui parle », les visions du passé : autant de procédés qui frôlent la parabole didactique. Le film veut dire beaucoup — trop ? — sur le temps, le progrès, la mémoire collective, les racines… au risque de ne jamais vraiment choisir entre comédie chorale, fable historique et manifeste citoyen.
Une jolie tentative, un peu bancale
La Venue de l’avenir n’est ni le plus grand film de Cédric Klapisch, ni une simple redite de ses succès passés. Il s’en dégage une douceur, une tendresse, un plaisir de cinéma qui emporte le spectateur malgré ses maladresses. La magie opère par moments, entre deux répliques convenues ou un travelling trop appuyé. On ressort avec le sentiment d’avoir vu une œuvre sincère, imparfaite mais habitée par l’envie de relier le passé au présent, les générations entre elles, et les spectateurs à ce qui nous lie.
🎟️Note : 3,5/5
Un film bancal mais attachant, trop explicatif mais visuellement soigné, qui brille autant par ses intentions que par ses limites. Un Klapisch généreux, qui croit encore en la magie des liens humains.